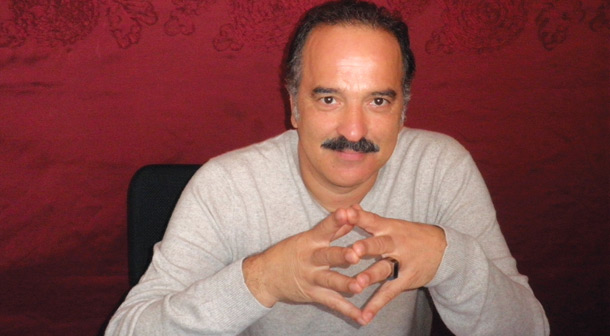
L’ivrEscQ : Pourquoi le choix de ce titre Il était une fois… peut être pas ?
Akli Tadjer : Parce que pour moi, une histoire que l’on raconte commence toujours par : Il était une fois… C’est le sésame pour entrer dans l’univers de l’auteur, sauf que dans ce cas, ce n’est peut-être pas une histoire, mais sans doute ce que j’appelle le «mentir» vrai. Se raconter à travers une fiction.
L. : Y a-t-il une lecture particulière des prénoms que vous donnez notamment à vos deux héros, Mohamed et Myriam, et aux autres personnages tels qu’Awa et Adam ?
A. T. : J’aime qu’à travers les prénoms des personnages de mes romans on sente déjà du vécu… Mohamed, Myriam, Awa, nous voilà plongés dans des prénoms de notre mémoire collective. ça sent le vrai, le rustique, l’éternel. Hormis cela, ce n’est pas tout à fait innocent. Vivant en France depuis toujours, j’aime interpeller mes lecteurs avec des prénoms très ciblés. C’est une manière de montrer qu’on peut être aussi le héros d’un roman en s’appelant Mohamed ou Myriam. Ce qui ne va pas toujours de soi. C’est pour cela que je le précise.
L. : Et qu’en est-il des deux peluches, Lucifer et Cruella, des noms qui traduisent la méchanceté, le mal ?
A.T. : Les peluches sont un peu les psychanalystes de Mohamed, le narrateur. C’est à elles qu’il confie ses joies et ses peines. Ce sont elles qui sont aussi les garantes de son histoire familiale. Moi aussi, il m’arrive de parler tout seul ou à des objets inanimés. «Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?», écrivait Lamartine. Je le crois. Peut-être en définitive, cela m’arrange d’y croire.
L. : Gaston et Malik, les deux soupirants de l’héroïne, sont tous deux jeunes et différents. De cet antagonisme découle le personnage Myriam qui symbolise la jeune femme cherchant sa voie…
A. T. : Oui, ces deux jeunes hommes sont l’exact opposé. J’ai voulu mettre Myriam, la fille de Mohamed, devant un choix auquel sont confrontés bien des jeunes filles issues de l’immigration. D’un côté, un jeune Français de souche, Gaston, bon vivant, et de l’autre Malik, un apprenti imam, austère mais fascinant.
L. : Votre roman puise principalement de votre vie privée, surtout quant à la condition féminine…
A. T. : Je crois avoir transmis à mes propres filles la liberté de penser par elles-mêmes, ce qui induit toutes les autres libertés car la liberté ne se divise pas. Étant entendu que ma liberté ne doit pas nuire à celle de mon voisin. Pour ce qui est de la laïcité, je n’imagine pas vivre dans un autre système. La religion est une affaire personnelle qui doit rester dans le domaine privé. Pour dire les choses plus crûment et pour citer un exemple, cela me choque de voir des fidèles, rue Myra à Paris, prier sur des cartons, entre crottes de chiens et papiers gras de sandwichs sous le regard pas forcément bienveillant des Gaulois du quartier. Mes parents qui n’avaient pas la possibilité de se rendre à la mosquée priaient à la maison. Cela ne leur serait jamais venu à l’esprit de son donner en spectacle comme ça.
L. : L’humour est très présent dans le roman, en particulier chez le narrateur (même dans les moments de colère). Considérez-vous que l’humour est utile à la maîtrise de soi et aide à mieux communiquer ?
A.T. : L’humour sert souvent de masque pour camoufler la violence de la vie et de certains sentiments. Par ailleurs, avoir un regard décalé ou du recul sur les événements permet d’écrire avec ce que vous appelez de l’humour. Pour ma part, lorsque je me relis et que je n’ai pas le sourire aux lèvres, je me dis que le lecteur doit s’ennuyer à mourir. Alors, je recommence jusqu’à ce que j’aie le sourire. Quand je ris avec moi-même, c’est carrément le bonheur.
L. : Vous revenez dans votre roman sur l’Histoire de l’Algérie en rapport avec la France coloniale, mais la version que vous donnez de cette Histoire est romancée…
A. T. : À la vérité, j’invente une Algérie qui m’arrange. Une Algérie de cinéma avec tout plein de couleurs, de soleil et rudesse. Une Algérie qui n’a jamais existé ailleurs que dans ma tête. Enfant, je passais mes vacances dans le hameau de mes parents, tout près d’El Kseur, en Petite Kabylie. De l’Algérie, je n’avais la vision que de l’aéroport et de ce trou avec dix maisons et un chemin de caillasses qui se perdait dans la montagne. C’était une vision de cauchemars et d’ennui. Les jeunes disaient, que derrière la maison au bout du chemin, c’était la fin du monde et le début de l’enfer. En somme le village était l’antichambre de l’enfer. J’avais fini par le croire tant cela paraissait plausible. Pour en revenir à l’histoire de l’Algérie, mes parents n’étaient pas très causants sur le sujet. À part la guerre d’indépendance et des bribes de la colonisation dont ils avaient souffert comme beaucoup d’Algériens, il leur manquaient des éléments du puzzle pour comprendre leurs conditions. C’est pour cela que je m’intéresse à ma façon à l’histoire de mon pays avec le décalage de quelqu’un qui n’y a jamais vécu…
Suite de l’entretien dans la version papier
abonnez-vous à L’ivrEscQ




Il n'ya pas de réponses pour le moment.
Laissez un commentaire