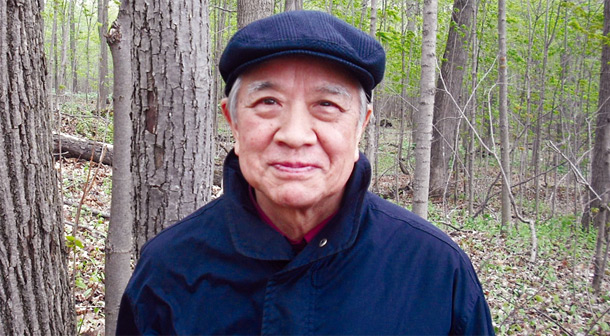
Mohamed Magani : Que faisiez-vous avant de commencer à écrire?Takashi Atoda : J’étais libraire et je collaborais dans des journaux. J’écrivais aussi des essais. En 1954, j’entrais au département de français de l’Université de Waseda (Tokyo), aspirant à devenir journaliste d’investigation. L’année suivante j’attrapais la tuberculose. C’est la fin de mon rêve. Long traitement et longue convalescence : je lisais, je dévorais surtout les nouvelles. La tuberculose a été vraiment le tournant de ma vie.
MM : Elle l’a été autrement pour moi. Mon frère l’a eue vers la même période que vous. Il écrivait beaucoup et tous ses écrits ont disparu, brûlés par mes parents, de crainte que la maladie ne touche ses petits frères. Les manuscrits perdus de mon frère, la réalisation de leur perte, a marqué mes débuts dans la littérature.
TA : Vous savez, pour être écrivain au Japon il faut trois conditions : il faut être tuberculeux, pauvre et avoir laissé tomber les études…
MM : Vous lisiez quels auteurs ?
TA : Des nouvelles de Maupassant, Somerset Maugham, Tchekhov…
MM : J’ai cru déceler dans vos nouvelles une influence de Raymond Carver. Un maître de la nouvelle dans la littérature américaine.
TA : Certes, j’ai lu Carver.
MM : Dans votre recueil de nouvelles The Square Persimmon ( The Square Persimmon, and other stories, translated by par Millicent M. Horton, Tuttle Publishing, 2000. NDLR) la révélation des mystères des choses du quotidien est à son summum, avec beaucoup de chaleur humaine. Mais il y a chez vous une insistance sur les rituels de la tradition et la poussée du passé.
TA : Mes nouvelles sont l’expression du milieu où je vis. Je ne peux échapper aux événements de la réalité. Et le poids de la tradition est encore très fort dans le Japon moderne.
MM : Vous avez dit un jour que les trois qualités essentielles dans l’écriture sont : le point de vue, le sens du réalisme, et le travail de réécriture judicieux.
TA : Mon état d’esprit principal quand j’écris est clair : c’est de divertir les lecteurs adultes avec des histoires riches. Pour satisfaire les lecteurs, je dois être attentif et garder un oeil sur ce qui se passe dans notre société. Quant au style des techniques, il existe toujours deux possibilités, soit on tire le thème des événements quotidiens, soit on imagine des astuces. Toutefois, il est très probable de tomber quelque part entre les deux positions. Donc, je travaille au cas par cas. Prenez la nouvelle «The Honey Flowers» (Les fleurs de miel) du livre que vous avez cité, c’est le rappel de mes souvenirs de guerre, mais j ai essayé d’y mettre, dans une certaine mesure, mes sentiments contre la guerre, ce qui veut dire que la nouvelle a été écrite avec une veine réaliste. Par contre, «Of Golf and its beginnings» (Du golf et de ses débuts), est composée d’une série d’astuces.
MM : Il y a, vers la fin de ce même livre, une nouvelle qui m’a fait bondir ! Soudain, le quotidien s’évanouit et le fantastique surgit. Je ne vous ai plus reconnu !
TA : (rires) Vous faites allusion à la nouvelle le «Traité sur le Comte St. Germain». Là, je me suis trouvé devant un paradoxe! Entre l’inconscient et le plan dressé à l’avance. Cela reflète mon caractère duel, pris entre la réalité et le fantastique. Je voulais devenir un scientifique, mais j’ai dû laisser tomber.
MM : Considérons, si vous le voulez, la littérature d’un autre versant. Quelle est la place de la politique dans votre oeuvre ?
TA : Personnellement, je peux à peine m’imaginer m’occuper de politique et d’idées politiques dans mes romans et nouvelles. Si je veux exprimer mes vues politiques ou des revendications, je le fais par le travail dans des organisations, qui n’ont aucune dimension dans mes livres.
MM : La question de l’environnement est aujourd’hui éminemment politique, elle est nettement perceptible chez vous… par exemple dans votre roman (Yamihiko, Prince of the dark, translated by Wayne P. Lammers, The Japan P.E.N. Club, 2010. NDLR)
TA : Cela dépend du style de l’auteur et de son attitude devant l’écriture. J’oserai dire qu’il est presque impossible de prendre en charge un sujet qui ne s’accorde pas avec le style de l’écrivain. De ce point de vue, la question n’est pas de savoir si l’écrivain doit s’inquiéter de l’état de la nature et de l’environnement, mais de s’interroger si son style d’écriture s’accorde, cadre avec ce sujet.
MM : En Asie, les rencontres entre écrivains sur la question de l’environnement se sont multipliées, depuis longtemps déjà.
TA : Je dois admettre également la corrélation profonde entre la littérature et l’environnement, mais nous avons besoin de reconnaître les différents niveaux de culture et de développement historique entre l’Asie et l’Europe en particulier, dans la sphère littéraire. L’Asie est moins développée que l’Europe, et la littérature asiatique a émergé au XXème siècle, c’est pour cette raison que les écrivains d’Asie sont plus sensibles à l’impact des aspects négatifs sur l’environnement et à la question de l’écologie.




Il n'ya pas de réponses pour le moment.
Laissez un commentaire