Amin Khan
Né en 1956 à Alger, il est l’auteur de plusieurs recueils de poèmes. Il figure dans de nombreuses anthologies, notamment dans celle que constitue Tahar Djaout en 1984, Les Mots migrateurs. Son dernier livre, Arabian blues (MLD, 2012) est préfacé par René Depestre. Il a été récompensé par le premier prix Méditerranée de poésie Níkos-Gátsos ainsi que par le prix de poésie François-Coppée de l’Académie française.
Tahar Djaout, poète assassiné à l’âge de 39 ans, est une figure emblématique du destin de l’Algérie.
Djaout, un homme jeune, au regard de feu doux et à la moustache fière. Un Algérien s’exprimant en tamazight, en arabe et en français. Un homme féru de mathématiques, de sciences, d’art et de littérature. Un amoureux des livres et de la vie. Un homme sensible, généreux, courtois, modeste, discret, au courage de granit et à la volonté farouche. Un homme lié à son terroir, à son pays et un homme gourmand du monde. Un rêveur de l’avenir, et, également, du passé de son peuple.
Tahar Djaout est le martyr d’une cause à la fois évidente, éclatante, mais pourtant encore indéfinie à l’heure de sa mort. On pourrait imaginer aujourd’hui, alors que vingt ans sont passés et que des rivières de sang fraternel ont raviné à jamais la terre algérienne, que la cause est entendue. Ce n’est pas le cas.
Quand on pense au martyre de Lorca, on pense à la terrible guerre civile espagnole. Quand on pense à celui de Djaout, il est impossible de penser aussi clairement. Y a-t-il eu une guerre civile en Algérie dans les années 1990 ? Ou non ? Mais alors que s’est-il passé dans ce pays durant la dernière décennie du XXe siècle ? Que s’est-il passé dans l’ordre du compréhensible dans la brutale éclipse qui a soudain recouvert et étranglé ce pays de lumière minérale ?
Le passage du temps ne peut, à lui seul, améliorer l’acuité visuelle des gens, de ceux qui voudraient savoir, ni même celle des savants et des historiens…
Il y a bien des hypothèses plus ou moins solides, des explications plus ou moins convaincantes, des convictions plus ou moins sincères concernant la véritable nature de ces années sinistres, mais à la vérité on se doit de dire que nous sommes aujourd’hui, comme nous l’étions il y a vingt ans, dans la confusion…
Au printemps 93, l’Algérie semble se tenir, chancelante, au bord d’un gouffre. Depuis plus d’une décennie, elle semble avoir perdu le cap, navire ivre, aphasique, cahotant, à la boussole trafiquée, où à l’heure du désastre pourtant, les misérables lampions d’une fête macabre s’allument sur le pont. La société, étourdie d’un méchant coup du sort sur la nuque, brisée dans son élan, s’enlise dans les premières marches d’un marécage historique insoupçonné. Le peuple, telle une chamelle aveugle, erre, blatère tant qu’il peut et se met à divaguer. Les maîtres de l’heure sont figés dans la lumière grise de la mauvaise conscience qui sourd encore, malgré tout, des fissures du décor national, les mains honteuses, tachées du sang des jeunes émeutiers d’octobre.
Ils sont figés dans une posture qu’ils ne saisissent pas bien eux-mêmes. Car en réalité, dans leurs murs et leur mutisme, ils s’agitent à trouver l’oxygène nécessaire à leur survie. Avec leur café nocturne, ils testent des échantillons de biscuits modernes pour la traversée. Ils parlent des différentes échéances, des différentes conceptions de l’au-delà du régime, ils examinent différentes possibilités, différentes façons de tenir ce peuple, entre eux, bien sûr, mais aussi avec leurs partenaires et complices du moment. Les maîtres de l’heure savent que l’heure tourne, que le mythe se délite tout à coup devant les yeux incrédules de la multitude des citoyens défaits, de la masse des fidèles à la recommandation de préférer l’injustice au désordre, pressentant qu’il y a pour notre destin pire que l’injustice, et pire que le désordre, qu’il y a quelque chose d’encore plus terrible, quelque chose comme la collusion de tous les crimes, qu’il y aura, à la fois, le pire des chaos et la plus cruelle des confusions, qu’il y aura la résurgence du malheur dont on pensait être sortis une courte génération plus tôt, à peine… (…)
Suite de l’article dans la version papier



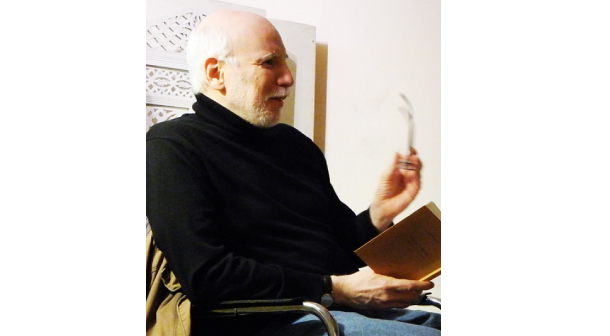

Il n'ya pas de réponses pour le moment.
Laissez un commentaire