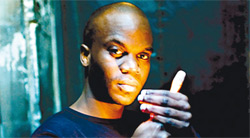
Gilbert Gatore appartient à la nouvelle génération d’écrivains africains. Dans cet entretien, il s’interroge sur le sens d’une tragédie humaine dans l’écriture romanesque : le génocide rwandais. Il parle à travers les deux voix de ses personnages, bourreau et victime, qui empruntent des chemins différents…
L’ivrEscQ : Le roman a pour cadre le génocide du Rwanda en 1994. Niko l’enfant bourreau malgré lui et Isaro, la victime échappée de justesse au massacre, constituent les deux Voix énonciatrices du récit. Le premier quitte le monde des humains et va se réfugier dans une grotte ; la seconde revient sur les lieux du génocide. Pourquoi ces deux Voix ?
Gilbert Gatore : C’est venu au fur et à mesure de l’écriture. Initialement, j’avais orienté le récit sur Isaro la jeune fille et il me semblait qu’il manquait quelque chose à cette mouture. J’ai mis beaucoup de temps pour me rendre compte que c’était, en fait, l’autre face de la médaille : l’aventure de Niko. C’est une histoire compliquée et complexe qui demande, je crois, un effort pour en saisir les nuances. Cette double voix était pour moi, une façon de nuancer le problème, c’est à dire de ne pas être dans le parti pris, dans la polémique, l’affirmation, mais au contraire dans les questions, l’interrogation qui me paraissent plus intéressantes.
Est-ce pour cela que vous avez donné la voix au bourreau et à la victime ? Pourtant, ces deux voix croisées tout au long du roman ne se rencontrent pas…
Non, elles ne se rencontrent pas sauf à la fin du roman où le lecteur peut comprendre qu’elles sont fidèlement, intimement liées puisque l’une (celle de Niko) est écrite par l’autre (celle de Isaro)
Niko, enfant bourreau quitte son village après une tentative de réinsertion après le massacre. Il se réfugie dans une grotte avec des gorilles. Est-ce un retour à la primitivité ?
En tout cas, on peut lire cela comme une imperfection ou une incapacité de la société humaine à traiter certaines natures du crime. Au-delà d’un certain seuil de la tragédie, on ne sait plus quoi faire avec les bourreaux et les victimes. C’est tellement démesuré qu’on ne sait plus quoi faire d’eux. C’est pourquoi Niko est tourmenté par des voix intérieures qui le poussent effectivement à s’isoler. Le châtiment qui ne vient pas de l’extérieur finit par surgir en lui.
Ne lit-il pas ce châtiment dans le regard tourmenté des gorilles ?
Oui, mais gardons-nous de rationaliser l’écriture parce que, à l’origine, ce n’est pas pensé de manière aussi précise que cela. On peut effectivement penser que ces gorilles-là lui infligent ce châtiment que les hommes n’ont pas été capables de donner. Au-delà de l’histoire du personnage de Niko, le Rwanda – ce nom n’est pas cité dans le roman, mais on le devine – est l’un des derniers endroits où il reste des gorilles de montagne. Il est vrai que ce sont des animaux un peu particuliers. Quand vous les regardez dans les yeux, vous doutez vraiment du sens du regard. Est-vous qui les regardez ou est-ce eux qui vous observent ? Cet épisode est lié à un souvenir d’enfance mais on peut l’interpréter aussi comme vous le dîtes.
À travers ces voix intérieures qui assaillent l’enfant bourreau, se construit une réflexion sur la mort, la mort violente…
C’est vrai. C’est une situation qui, quand on la vit, ne peut laisser que des interrogations. Je dois vous dire, qu’à posteriori, une fois le roman achevé, je me suis rendu compte que le livre était composé à 50% de phrases interrogatives au sujet de la mort. L’expression de ce basculement force à se poser des questions surtout quand cette tragédie arrive à l’échelle à laquelle elle est survenue. Toutes les questions que je me suis posées moi-même se trouvent dans le roman. Elles sont amenées par les deux personnages dans les situations qu’ils traversent.
Peut-on dire que Niko, au même titre que tous les enfants-soldats en Afrique ou au Liban lors de la guerre civile est déshumanisé ?
Sur ce point, il me semble qu’il y a deux considérations. La première, d’un point de vue juridique et éthique, on pourrait condamner sans appel Niko. Ce qui ne serait que justice. Mais, dans une approche d’écriture littéraire, comme j’ai l’habitude de l’expliquer, on est obligé de considérer que même le bourreau a une famille, des parents, des pensées autres que celles des crimes qu’il a commis ; il s’interroge, a des projections dans l’avenir. On n’est jamais intégralement mauvais comme on pourrait le croire. Mais, encore une fois, si on regarde les choses d’un point de vue juridique et éthique, Niko est condamnable pour les crimes qu’il a commis.
Le récit de Niko est donné sous une forme télégraphique avec de brefs passages numérotés. Pourquoi ce choix esthétique ?
C’était la seule façon d’être dans le récit tel que je le voulais pour ce personnage-là. Je me suis refusé au récit linéaire. Niko voit les choses arriver dans le désordre, comme elles surviennent dans la vie courante. Ces différents flashs de pensée ne sont pas liés et la seule manière de les rendre dans ce même désordre qui au fur et à mesure prend un sens et dessine l’état intérieur de ce personnage, c’était d’écrire de manière fragmentée.
Suite de l’entretien dans la version papier
abonnez-vous à L’ivrEscQ




Il n'ya pas de réponses pour le moment.
Laissez un commentaire