Traces de temps long et épilogue colonial
Sans méconnaître un passé plus ancien, remontons d’abord à 1830 et aux quatre décennies qui suivirent. Les morts algériens de l’implacable conquête de l’Algérie ont été évalués entre 250 000 et 400 000. Les victimes de la destructuration du vieux mode de production communautaire, en particulier lors de la grande famine de 1867-68 suite à une récolte désastreuse, furent bien aussi nombreuses, et peut-être plus : au total il y eut disparition peut-être bien d’un quart à un tiers de la population algérienne de 1830 à 1870. La population se mit à remonter à partir de la fin du XIXe siècle, plus du fait de ce que les Québécois appellent la «revanche des berceaux» que de la médecine : en 1914, l’Algérie, colonisée depuis 84 ans, compte 77 médecins de colonisation, moins qu’au Maroc, dont l’occupation a commencé sept ans plus tôt. Il y eut en Algérie aussi dépossession de 2,9 millions d’ha sur 9 millions cultivables : le tiers en quantité, mais plus en qualité car ce furent les meilleures terres qui furent prises – du fait des confiscations, des expropriations pour cause d’utilité publique, de saisies pour dettes de paysans insérés de gré ou de force dans le système monétaire et ayant dû mettre leurs terres en gage. Quant à l’œuvre d’éducation tant vantée, d’après les chiffres officiels, 5% de la population était scolarisée dans les écoles françaises en 1914, moins de 15% en 1954 ; et elle n’augmenta qu’in fine durant la guerre de libération et du fait du plan de Constantine. La langue arabe, reléguée au second plan, n’était enseignée dans le système français que dans les trois «médersas» officielles, puis les «lycées franco-musulmans» après la 2e guerre mondiale. Le congrès des maires d’Algérie de 1909 avait voté une motion demandant «la disparition de l’enseignement indigène», au désespoir du recteur Jeanmaire, apôtre de l’école républicaine française. La discrimination fut aussi fiscale: les «impôts arabes» spécifiques («achour», «hokor», «lezma», «zakât») sont payés par les Algériens jusqu’en 1918, dans la continuité du beylik de l’époque ottomane, et avec sensiblement les mêmes taux. S’y ajoutent les «centimes additionnels » et la corvée–formellement, l’assimilation fiscale fut édictée en 1918. Ce furent ainsi largement les paysans algériens, dont entre le 1/3 et le 1 /5 de leurs revenus s’envolait en impôts, qui financèrent la colonisation française, c’est à dire leur propre dépossession. Au politique, l’égalité dans une citoyenneté commune fut refusée pendant longtemps; et elle ne fut qu’esquissée avec le statut de 1947. Comment l’historiographique coloniale a-t-elle traduit ces données historiques indubitables ?



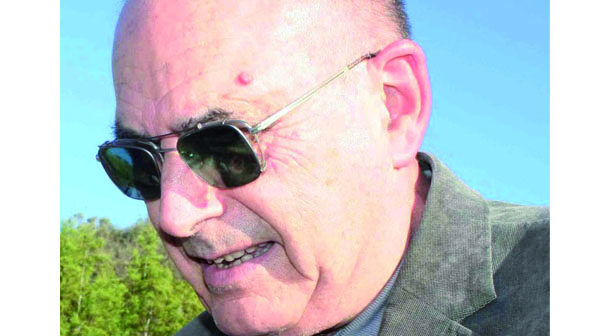

Il n'ya pas de réponses pour le moment.
Laissez un commentaire